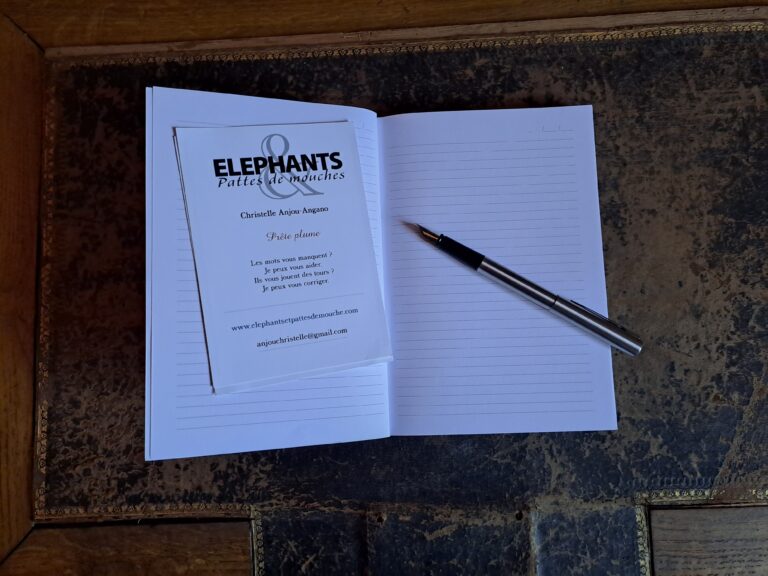La rencontre
Le soleil brille ce matin sur l’océan. Les vagues se sont endormies, bercées par les
cris des albatros et des goélands. Leurs ailes, immenses, caressent l’onde.
Cela fait quelques semaines que nous avons pris la mer. Jusqu’à la nuit dernière,
tout se passait bien. Le capitaine connaît par cœur son voilier. Il n’a pas son pareil pour
bénéficier des alizés qui lui permettent d’approcher les courants du Gulf Stream.
L’approche du port du Havre sera plus délicate, elle l’est toujours, notamment du fait de
l’envasement et des marées.
« O albatroz branco », l’albatros blanc, le bien nommé, le magnifique. Un trois-mâts
de cent trente pieds, immaculé, étincelant sous le soleil. Ses cales regorgent de café, de
poudre d’or, de peaux de chinchillas et de castors, mais aussi de billes de bois de
palissandre, de sucre et de tapioca. Tout cela sera débarqué au port du Havre dans
quelques jours ; puis, le navire remontera la Seine jusqu’à la ville de Rouen. Là
débarqueront les quinze passagers qui ont payé pour faire la traversée, parmi lesquels
quelques missionnaires français qui reviennent au pays, fiers d’avoir accompli leur
mission. Au retour, le navire sera chargé de passementerie, de sellerie, de fromages, de
souliers, de précieux médicaments, et enfin, de coutellerie.
Personne ne m’a vu embarquer. Eo sou o clandestino, je suis le clandestin. Je suis
partout, mais on ne me voit pas. Chez moi, on me nomme parfois le Curupira. Je suis le
protecteur de la forêt. Le palissandre embarqué est mien, ainsi que les chinchillas et les
castors. Encore une fois, on les a arrachés à leur terre pour le bien être des plus riches,
là-bas. Au pays, on me craint. On a appris à se méfier de ma chevelure de feu, de mes
pieds retournés qui font se perdre les braconniers trop gourmands. Je suis l’Intemporel :
avant, il n’y a pas si longtemps de cela, les cales étaient pleines de pauvres hères
enchaînés. J’étais déjà là, me glissais parmi eux, ressentais leur peur, leur désespoir, leur
colère contre ces hommes qui venaient les arracher à leur terre, leur femme, leur culture,
s’en remettant aux orixás de la religion Candomble, arrivée du continent africain avec les
premiers esclaves noirs.
Avec le temps, les hommes enchaînés ont laissé la place aux marchandises, mais
les orixás sont toujours là. Je les sens, je les vois. Ils ont prié si fort. Oui, aussi beau soit-il,
ce navire a conduit des hommes vers l’enfer. Et je les entends encore. Le bois de la coque
est imprégné de leurs larmes, et a été arraché à ma forêt.
Sur le pont, les hommes s’étirent. La nuit a été rude. Déchaînés, les éléments ont
mis à mal l’embarcation, de taille pourtant respectable. Les hommes rient fort, un peu trop
peut-être. C’est le rire de bravade de celui qui a eu peur de mourir, et qui n’en revient pas
d’avoir survécu. Alors, on se roule une cigarette, on se bourre une pipe, on tente d’oublier
qu’une nouvelle nuit viendra, puis une autre encore. D’autres tempêtes suivront
également, ponctueront leur vie de marins. Certaines vous emporteront. Ce sera ton cas,
Jao, toi qui ris plus fort que les autres, et toi, Leandro, qui pour le moment t’extasies
devant les sauts du banc de dauphins qui nous accompagne. Les plus chanceux
honoreront votre mémoire dans de longs récits qu’ils ne manqueront pas de raconter,
lorsque l’âge ne leur permettra plus de partir en mer. Jao, Leandro, vous appartenez à
l’océan, mais vous ne le savez pas. Vous appartenez à Lemanja, la déesse de la mer, que
vos ancêtres ont emmenée avec eux lorsqu’ils ont été arrachés à leur terre d’Afrique. Oui,
la lame qui vous emportera n’est pas encore formée, mais vous êtes déjà sienne et les
larmes de vos mères se mêleront à l’océan salé. Quant à toi Manolo, tes grands yeux gris
sont déjà le miroir de la folie qui s’emparera de toi. Tu n’es pas fait pour les horizons infinis
et La Peur qui s’est insinuée en toi ne te quittera plus. Elle t’emprisonnera, te rongera et
finalement t’emportera. Oui, cette traversée sera ta dernière, et tu es en train de le
comprendre, toi qui as prié toute la nuit en ravalant tes larmes. Je t’ai entendu appeler ta
mère en gémissant. Tu es là, adossé au mât de misaine, le regard noyé par la peur. Tu
penses que si tu veux revoir ta mère et ton pays, il te faudra de nouveau affronter l’océan
et tu sais déjà que tu en seras incapable. Ce que tu ignores en revanche, c’est que tu es
condamné à ressentir le roulis sous tes pas, que tu ne pourras plus t’allonger dans un lit
sans avoir peur de sombrer. Oui, tu es condamné aussi sûrement que si tu avais été
emporté par une des déferlantes qui se sont acharnées la nuit durant sur votre coquille de
noix. La vie se montre scélérate parfois.
Quelques matelots se lancent maintenant dans une démonstration de capoeira. On
les acclame, on les encourage. Bien sûr, la démonstration est pacifique, mais c’est bien
d’une manifestation de force qu’il s’agit. Les corps, à moitié nus, se défient, se jaugent,
évoluent, moitié danse, moitié combat. Le capitaine, fin psychologue, a décidé de laisser
faire ; pourtant il n’est pas dupe. Il connaît le sens caché de cet art, ses origines. Tout en
regardant ses hommes évoluer, il apprend à les mieux connaître, et peut-être à mieux s’en
méfier. la capoeira répond à des règles très précises, rien n’est laissé au hasard. Il
n’ignore pas que dans chaque pas de danse sommeille un éventuel coup porté. Petit à
petit, le rythme s’empare d’eux. C’est le sang de leurs ancêtres, leur lutte pour la liberté,
qui brûle dans leurs veines.
— Capitaine… Vous les laissez faire ?
— Ne vous inquiétez pas. Plus qu’une démonstration de force ou de violence, cette
séance est un exutoire. La nuit a été longue. Pas question de les en priver.
Acrobaties, coups de pied, esquives, les figures s’enchaînent. On chante
maintenant pour les accompagner. Aujourd’hui, ils règlent leur compte à la tempête qui les
a défiés la nuit durant.
8 mai,
Nous voilà enfin arrivés. Comme toujours, le capitaine a su diriger son trois-mâts
avec brio. La Manche était à son étale, facilitant l’entrée au port. Nombreux sont ceux qui
sur terre, comme dans l’eau, nous ont accompagnés ; une entrée triomphante, sous les
timides rayons du soleil normand. Sur les quais Il a fallu plusieurs heures pour vider les
cales. C’est un peu de nos forêts qui vont rejoindre les autres marchandises dans les
docks du port. Les peaux de castor rejoindront les ateliers de chapellerie, la fourrure des
chinchillas ornera les plus beaux manteaux. Comme je les méprise ces hommes et ces
femmes qui, pour assouvir leur goût du luxe, appauvrissent ma forêt.
L’équipage a quartier libre pendant quelques heures, puis nous repartirons. Ils
partent à l’aventure, bras dessus bras dessous, improvisent une roue ou quelques pas de
danse. On rit fort quand on croise les filles du port, on avance crânement, sifflant dans un
clin d’œil facétieux. Seul Manolo est resté à bord. Depuis la tempête, il n’a cessé de
trembler. Ses yeux gris semblent s’être encore agrandis. Rien ne semble pouvoir
l’atteindre désormais, ni le rire de ses compagnons de voyage ni leurs encouragements. Il
est déjà loin. Je crois qu’il me voit. Les passagers, quant à eux, attendent patiemment de
retrouver leurs proches. Ils seront débarqués à Rouen.
Nous avons repris la route, précédés par deux goélettes anglaises. La Seine s’offre
à nous. Elle me semble ridiculement sage comparée à mon Amazone. Enfin, nous
arrivons. Les clochers de la ville se devinent maintenant. Sur les quais de la Seine, les
promeneurs nous acclament, les enfants nous font signe, les jeunes filles nous envoient
des baisers. Les missionnaires voient se rapprocher leur ville avec émotion. Ils sont
impatients de s’en remettre à saint Romain, protecteur de leur ville, impatients de se
recueillir dans leur cathédrale. Peut-être auront-ils quelques lourds secrets à confesser.
C’est alors que je l’aperçois.
Il est seul, étendu sur l’herbe de son jardin. Un platane majestueux le protège du soleil.
Notre apparition semble le réjouir. Son sourire d’homme nanti m’irrite, sans que je ne
m’explique pourquoi. Il symbolise pour moi celles et ceux pour lesquels mon peuple a
saigné, a transpiré, a souffert. Je repense aux chinchillas et de castors braconnés pour
qu’en Europe, on puisse porter de beaux chapeaux, de belles pelisses.
C’est alors que le chant d’airain des mille clochers nous parvient. C’est le signe. Elles
annoncent notre rencontre, aussi sûrement que le glas annonce la mort du fidèle.
Pauvre homme ! C’est sur lui que je décide de jeter mon dévolu. C’est lui qui paiera
la facture. Il paiera pour les chinchillas, les castors, et le bois de palissandre. Il paiera pour
les plantations de café, celles de coton.
Il ne le sait pas encore, mais je le possède déjà. Curupira dans mon pays, je serai
pour Lui le Horla. C’est ainsi qu’il me nommera. Je lui révélerai ses peurs les plus
profondes. Avec moi, il connaîtra la solitude à son apogée et pour finir la folie la plus
totale.
Alors, il sera temps pour moi d’attendre un nouveau trois-mâts pour regagner ma
forêt amazonienne, mon palissandre, mes castors et mes chinchillas.
Christelle Angano